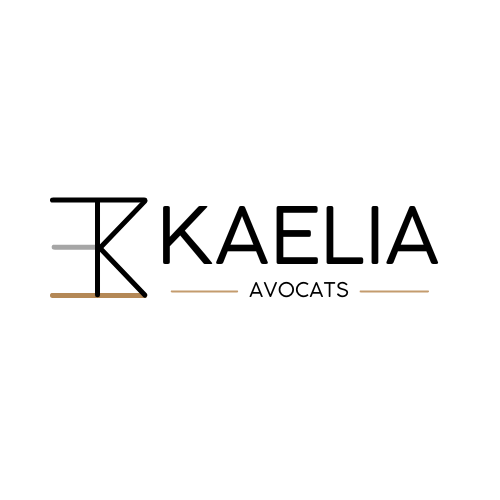Contrat de droit privé de la commande publique : Après l’heure ce n’est plus l’heure
Défini par aucun texte, le contrat de droit privé de la commande publique est un contrat hybride, privé par sa nature et public par son objet. Ce contrat est conclu essentiellement par des personnes morales de droit privé. Ces mêmes personnes sont soumises, pour la passation des contrats répondant à leurs besoins que ce soit en matière de travaux, fournitures ou encore services à des procédures préalables de publicité et de mise en concurrence en application des règles de la commande publique. En pratique, ces contrats sont nombreux et concernent, notamment, les marchés publics passés par les entreprises publiques nationales telles que les sociétés du groupe EDF ainsi que ceux passés par la plupart des entreprises publiques locales (cf. sociétés d’économie mixte ou sociétés publiques locales) et de nombreuses associations sous influence publique. Ces contrats sont soumis au contrôle du juge judiciaire.
Par une décision du 22 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée concernant l’application de l’article 37.2 du CCAG[1] fournitures courantes et services (le « CCAG-FCS ») approuvé par arrêté du 19 janvier 2009 et contractualisé par un acheteur public – personne privée (le « pouvoir adjudicateur »). Aux termes de cet article :
| « tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées, qui doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ». |
A l’origine de cette décision, étaient en cause deux marchés publics ayant respectivement pour objet la désinfection, désinsectisation et dératisation des groupes immobiliers (marché 3 D) ainsi que la détection et le traitement des punaises de lit (marché punaise de lit) conclus avec une seule et même société (le « titulaire »). Le premier marché a été conclu en novembre 2013, renouvelé à plusieurs reprises et pris fin le 30 juin 2018. Le second a été conclu le 8 janvier 2019 puis, résilié unilatéralement par le pouvoir adjudicateur le 4 mars 2019.
Le 8 janvier 2018, le titulaire a mis en demeure le pouvoir adjudicateur de lui payer la somme de 149 686,15 euros correspondant à plusieurs factures impayées. Le pouvoir adjudicateur a contesté les sommes réclamées plus d’un an après, le 10 février 2019. Plus de deux mois après, les 18 juin et 3 juillet 2019, le titulaire a adressé de nouveaux décomptes dont elle a demandé le paiement. Le 16 mars 2020, le titulaire des marchés à assigné en référé[2] le pouvoir adjudicateur en paiement de diverses provisions, dont 97 901,96 euros au titre de factures impayées et 128 545,06 euros au titre des intérêts et indemnités forfaitaires de recouvrement.
Jugeant dans le même sens que le Conseil d’État[3], la chambre commerciale a estimé que le mémoire visé par l’article 37.2 du CCAG « doit être adressé à l’acheteur dans un délai de deux mois suivant la naissance du différend, sous peine de forclusion, ce dont il se déduit que ce mémoire ne saurait avoir établi et adressé à cet acheteur antérieurement à la naissance du différend ». Par suite, elle a constaté que le différend était matérialisé par le rejet du pouvoir adjudicateur du 10 février 2019 et non par les lettres de mises en demeure qui étaient antérieures à la naissance du différend. En conséquence, il a été jugé que les mémoires en réclamation, matérialisés par les lettres du 18 juin et 3 juillet 2019 étaient tardifs et que les prétentions du titulaire étaient irrecevables.
En cassation, le débat n’a pas porté sur la question de la contractualisation du CCAG qui aurait pourtant mérité de se poser à l’aune des règles encadrant les clauses abusives.
Il est intéressant de relever qu’en première instance, le titulaire soutenait que le pouvoir adjudicateur « ne peut valablement se prévaloir des règles du droit administratif relatives à la forclusion ». Maladroitement formulée, cette prétention était rejetée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris de manière toute aussi maladroite. Dans son ordonnance, le Tribunal jugeait ainsi que « Contrairement à ce que soutient la demanderesse, il incombe aux juridictions de l’ordre judiciaire de faire application de ces règles de droit administratif dans les litiges relevant de leur compétence portant sur l’exécution de contrats soumis à ces règles »[4].
Particulièrement conciliante à l’égard des pouvoirs adjudicateurs de droit privé, cette ordonnance était d’autant plus contestable que le Conseil constitutionnel précisait seulement quatre mois plus tard que « les contrats administratifs et les contrats de droit privé répondent à̀ des finalités » mais surtout « des régimes différents »[5]. Si la différence de finalité des contrats administratifs et de droit privé ayant pour objet une commande publique est contestable et a été logiquement contestée[6], la seconde partie concernant la différence de régimes, notamment en phase d’exécution, est moins discutable (et moins discutée).
La Cour d’appel de Paris, saisie à son tour n’a pas repris cette motivation de première instance mais adopté un raisonnement purement contractuel. Elle a ainsi interprété le contrat et constaté que les deux marchés renvoyaient au CCAG-FCS approuvé par arrêté du 19 janvier 2009, pour juger que « contrairement à ce que soutient l’appelante, les stipulations dudit cahier des clauses administratives générales approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 s’appliquent donc bien au litige »[7]. Par ailleurs, la Cour d’appel a jugé que le système de forclusion prévu par l’article 37.2 du CCAG-FCS respectait les règles de droit privé et ne portait aucune atteinte aux règles de prescriptions contenues aux articles 2220 et suivants du code civil. Après avoir jugé que l’article 37.2 du CCAG-FCS était applicable au litige, la Cour s’en est tenue à une application stricte et assumée des jurisprudences juge administratif.
Finalement, la Cour de cassation saisie du pourvoi ne s’est pas prononcée sur le caractère exorbitant ou abusif de cette stipulation, pour autant la question de savoir si les clauses des CCAG sont abusives mérite d’être posée (certaines le sont assurément). Relevons d’ailleurs que les opérateurs économiques, parties à un contrat de droit privé de la commande publique ont été invités par la troisième chambre civile à contester les clauses contenues dans les documents contractuels, CCAG compris, en soulevant leur caractère exorbitant et, le cas échéant, abusif afin d’obtenir qu’elles soient écartées[8].
En définitive, le débat concernant la contractualisation des CCAG dans les contrats de droit privé de la commande publique est loin d’être tranché. Aussi, les sociétés titulaires de marchés publics de droit privé qui ne sont pas toujours rompues aux règles de la commande publique sont invitées à la plus grande vigilance, au même titre que les pouvoir adjudicateurs dont les contrats relèvent du contrôle du juge judiciaire qui seraient tentés de voir par cette décision de la Cour de cassation, un blanc-seing à toute contractualisation pure et simple des CCAG.
[1] Cahier des clauses administratives générales
[2] Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile
[3] CE, 11 août 2009, APHP, n°326791 ; CE, 3 octobre 2012, n°349281
[4] TJ Paris, 25 juin 2020, ord. Référé n°20/52920
[5] CC, 2 octobre 2020, Société Bâtiment Mayennais, n°2020-857 QPC
[6] F. Llorens et P. Soler-Couteaux, Les contrats de la commande publique à l’épreuve de la distinction entre contrats administratifs et contrats de droit privé : Contrats-Marchés publ. 2018, repère 2. – M. Karpenschif, Haro sur les contrats de droit privé de la commande publique : AJDA 2020, p. 2281.
[7] CA Paris, 7 mai 2021, n°20/09974
Cass., civ. 3ème, 11 mai 2022, Société les compagnons paveurs, n°21-12.291